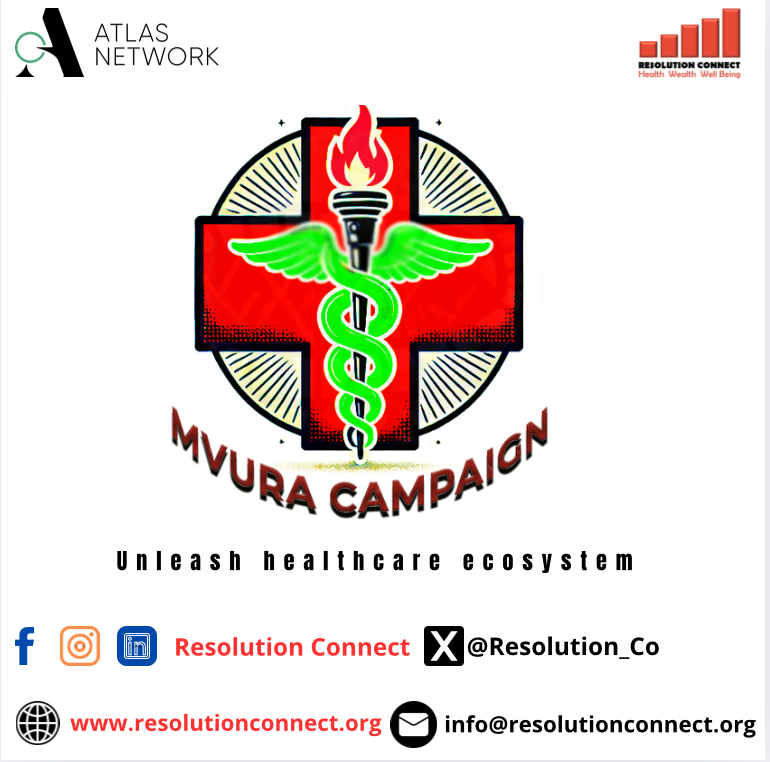10-01-2025

Le secteur public : une couverture inégalement répartie.
Le secteur public joue un rôle central dans le système de santé burundais. En effet, 63 % des centres de santé et 43 des 48 hôpitaux fonctionnels sont gérés par l’État. Ce contrôle étendu permet à l'État de réguler, planifier et coordonner les services de santé à l’échelle nationale, assurant ainsi une couverture relativement uniforme, notamment dans les zones rurales. Le secteur public ne se limite pas à la prestation des soins, mais s’étend également à la formulation des politiques sanitaires, à la gestion des ressources et à la régulation des pratiques de santé.
Cependant, cette domination du secteur public comporte plusieurs inconvénients. Bien que l’État garantisse une couverture de soins de base à une large frange de la population, cette centralisation engendre une dépendance vis-à-vis de l'État et freine l’innovation. De plus, face à des ressources souvent limitées et à la saturation de certains services publics, la qualité des soins peut varier. Cette disparité crée des inégalités d’accès, notamment dans les zones urbaines, où la demande est plus pressante.
Le secteur privé : défis de développement et frein à l’innovation
Le secteur privé dans le domaine de la santé au Burundi demeure limité et souvent mal perçu. Comme l’indiquent les récentes décisions de suspendre certaines structures sanitaires et pharmacies privées, et l’interdiction d’ouverture de nouvelles structures depuis fin 2024, le secteur privé peine à se développer. Bien que quelques cliniques privées et pharmacies existent, leur nombre reste insuffisant pour répondre aux besoins croissants d'une population en quête de soins de qualité.
Les structures privées font face à de nombreux défis : un manque de supervision rigoureuse, une absence de contrôle qualité, une faible transparence des données, et une méfiance généralisée du public. En outre, malgré l’existence de certains services spécialisés dans les cliniques privées, celles-ci peinent à suivre le rythme de croissance de la demande. Le principal frein à leur développement réside dans l’absence d’un cadre réglementaire clair et incitatif pour les investisseurs privés, ce qui limite les investissements dans les infrastructures et la diversification des services de santé privés.
Le monopole public : un obstacle majeur à la diversification des services
Le monopole public dans le domaine de la santé est l’une des raisons principales pour lesquelles le secteur privé peine à se développer. En contrôlant la majorité des services de santé, l’État restreint l’espace d’action du secteur privé. Ce monopole crée une situation où les acteurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers, doivent lutter pour s’impliquer dans un environnement où les ressources, la régulation et l’accès au financement sont largement dominés par le secteur public.
Ce contrôle restreint également la diversité des services disponibles. Les entreprises privées, notamment celles à but lucratif, ont du mal à se diversifier et à investir dans des services spécialisés, faute de soutien gouvernemental. Cela freine la concurrence et empêche l’émergence de solutions innovantes susceptibles d’améliorer la qualité des soins. La présence de prestataires privés, capables d’offrir des alternatives flexibles et personnalisées, pourrait pourtant stimuler une dynamique de qualité et d’innovation dans le secteur de la santé.
Le libre marché : un moteur potentiel pour le développement du secteur privé
L’introduction du libre marché dans le système de santé pourrait constituer un levier important pour stimuler le secteur privé. En favorisant la concurrence, un marché libre inciterait les prestataires privés à améliorer la qualité de leurs services pour attirer les patients. Cette concurrence pourrait également contribuer à réduire les coûts des soins, les rendant ainsi plus abordables, en particulier pour les populations urbaines.
Un tel système offrirait également davantage de possibilités d’innovation. Le secteur privé pourrait investir dans des technologies avancées, offrir des soins spécialisés non disponibles dans les établissements publics et diversifier ses services pour mieux répondre aux besoins spécifiques de la population. Par exemple, les cliniques privées pourraient proposer des services de santé plus personnalisés et de meilleure qualité, créant ainsi un environnement compétitif où le patient serait au centre des préoccupations.
Cependant, pour garantir le succès de cette approche, une régulation rigoureuse est indispensable. L’État doit mettre en place un cadre législatif clair, qui garantisse la qualité des soins tout en soutenant le développement du secteur privé. Il est également crucial de renforcer les mécanismes de supervision et de contrôle pour éviter toute dérive et assurer la protection de la santé publique.
Les partenariats publics-privés : un potentiel sous-exploité
Les partenariats publics-privés (PPP) représentent une solution stratégique pour intégrer les forces du secteur public et du secteur privé dans le système de santé. Toutefois, ces partenariats sont souvent inefficaces au Burundi, en raison d’un cadre juridique et réglementaire insuffisamment développé, d’un manque de transparence et de mécanismes de gouvernance inadaptés. Lorsque les deux secteurs ne collaborent pas de manière optimale, les bénéfices attendus, tels que l’amélioration de l’accès aux soins et la réduction des coûts, demeurent limités.
Pour que ces partenariats atteignent leur plein potentiel, il est essentiel de définir des stratégies claires et d'assurer une coordination efficace entre les deux secteurs. Cela allégerait la charge du secteur public tout en renforçant le rôle du secteur privé dans l’offre de soins de santé, permettant ainsi d’atteindre une couverture plus large et plus équitable.
Commentaires
Autres Articles